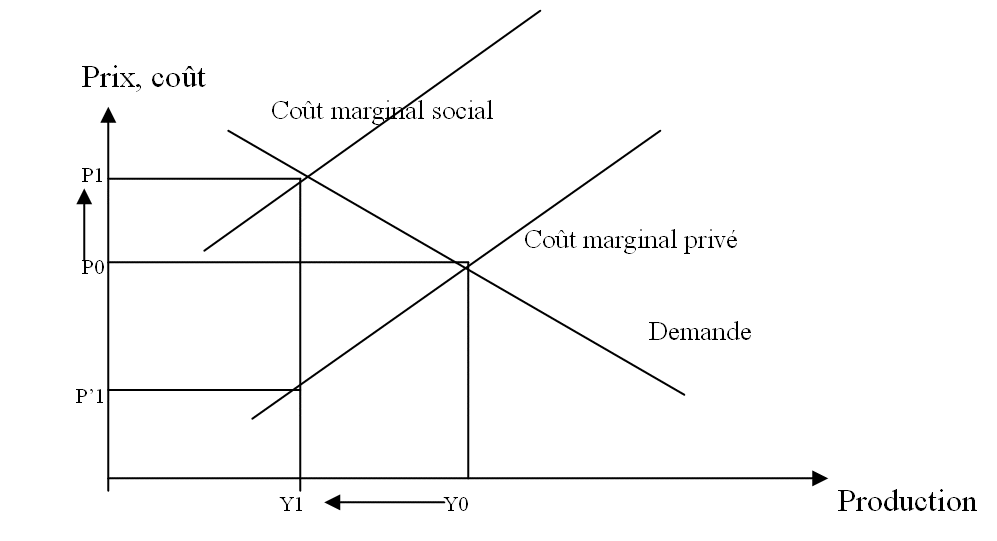I)
Le problème de la pollution et sa résolution.
A)
L’échec de la main invisible : la nécessaire intervention
de pouvoirs publics.L’externalité
: une défaillance du marché
L’externalité
est la conséquence de l’action d’un agent économique
sur d’autres agents sans que celle-ci soit prise en compte par le marché,
sous la forme d’une compensation ou d’une rémunération
grâce au système de prix. Aucun mécanisme de marché
ne fonctionne spontanément pour corriger, dans un sens ou dans l’autre,
ce type de comportement.
L’externalité
peut être positive quand elle procure une amélioration
de bien être pour un autre agent. L’invention d’une nouvelle
technologie permet à d’autres entreprises de réaliser des
gains de productivité et de développer d’autres innovations...
L’externalité
peut être négative quand elle se traduit par la
diminution de bien être de d’autres agents. La construction d’une
prison fait chuter la valeur immobilière des propriétés
alentour. La pollution est donc l’exemple type d’une externalité
négative.
Pour
arriver à une situation optimale (pareto-optimale), celle où la
richesse totale (ou collective) est maximale, le coût externe lié
à la pollution doit être pris en compte par le marché, en
l’occurrence par le pollueur. On dit qu’il faut internaliser les
externalités. L’internalisation consiste à faire peser sur
les agents économiques la totalité des coûts de leurs actions.
Un des moyens d’y parvenir est de taxer les pollueurs (solution pigouvienne
du nom de l’économiste Pigou (1932) qui a défini pour la
première fois le concept d’externalité comme un défaut
de marché).
L’intervention
des pouvoirs publics : le rôle des écotaxes
Supposons
que le niveau de dépollution à atteindre, par la baisse de la
production génératrice d’externalités, soit une donnée
exogène et résulte par conséquent d’une décision
politique (l’évaluation monétaire des bénéfices
de la dépollution étant un calcul extrêmement difficile
même si le rapport Stern estime le coût socio-économique
du réchauffement climatique à 5 500 milliards d’euros).
L’analyse économique se concentre alors sur le choix du moyen qui
permet d’atteindre l’objectif de dépollution au moindre coût.
De nombreuses études ont montré que le recours aux écotaxes
présentait des avantages évidents.
L’objectif
de la fiscalité écologique n’est pas de collecter des ressources
de la manière la plus neutre possible mais au contraire de corriger les
imperfections de marché, et en particulier de faire en sorte que les
agents prennent en compte les externalités dans leurs calculs économiques
pour corriger leur comportement. La fiscalité se substitue donc aux normes
pour faire baisser la pollution.
Il s’agit d’amener le coût privé de la production au
niveau du coût social, qui inclut les dommages causés aux autres
agents (principe du pollueur-payeur).
P1 = P’1 + Taxe écologique
La taxe élève la courbe de coût marginal, conduisant à
une baisse de production de Y0 à Y1.
Toute
la difficulté des taxes pigouviennes est rappelons-le de bien apprécier
le coût social des dommages et donc d’évaluer le niveau de
dépollution dont on escompte tirer un bénéfice pour la
société mais aussi de connaître la réactivité
des comportements aux coûts. Une erreur sur la pente de coût marginal
(une courbe plus pentue que prévue) limite la baisse de la production
et donc la réduction des émissions polluantes. Une autre solution
consiste à fixer par la réglementation et la norme le niveau des
émissions. Mais le coût de leur réduction risque d’être
élevé.
Quoi
qu’il en soit, la taxe est, dans la plupart des cas, jugée plus
efficace (plus efficace car moins coûteuse que la norme d’émission).
En
effet, contrairement à la norme d’émission, la taxe (par
unité de pollution) laisse un choix à l’entreprise réglementée.
Elle peut décider de maintenir le niveau de ses émissions. Elle
évite alors des dépenses d’améliorations de ses performances
environnementales mais paie une taxe totale élevée. Les sommes
ainsi collectées pourront financer des dépenses de préservation
de l’environnement. L’entreprise peut aussi choisir réduire
les émissions polluantes. Ce qui entraîne des dépenses d’amélioration
de ses performances environnementales, mais diminue sa dépense fiscale.
Le principe général de la taxe est d’inciter le pollueur
à dépolluer jusqu’à ce que le coût de dépollution
soit égal au montant de la taxe. Ainsi les entreprises disposant d’une
technologie de production plus moderne et donc moins coûteuse, dépollue
plus et à moindre coût que les autres entreprises. Globalement
le résultat de la politique de dépollution par la taxe est moins
coûteux que la mise en place d’une norme quantitative uniforme.
C’est d’autant plus vrai en situation d’information imparfaite.
Pour atteindre son objectif de dépollution, le réglementeur peut
procéder en plusieurs étapes en modifiant à chaque fois
le niveau de la taxe. S’il observe un niveau trop élevé
d’émission il augmente le niveau de la taxe et inversement...Il
peut ainsi par tâtonnement se rapprocher de l’objectif recherché.
Enfin
les écotaxes permettent d’aller au-delà des normes préexistantes.
Ainsi la taxe suédoise sur le souffre s’est traduite dès
1991 par des niveaux d’émission très inférieurs à
la limite légale, jusqu’à 50 % pour les fuels.
B)
L’option envisageable des solutions privéesLe
théorème de Coase : la « négociation bilatérale
».
Ce
théorème a été énoncé pour la première
fois par Stigler. Il suggère que si les droits de propriété
sont définis (un agent privé, que ce soit le pollueur ou le pollué,
est alors propriétaire de la rivière, du lac ou de la forêt)
et si les coûts de transaction sont nuls (l’identification
des partenaires de l’accord, la rédaction du contrat, le suivi
de sa bonne exécution, la mise en place d’un système de
sanction en cas de défection ne doivent rien coûter) les agents,
par la négociation, corrigent d’eux-mêmes les externalités
pour arriver à une situation optimale.
Pourtant,
Coase lui-même, intéressé qu’il est par les institutions,
réfute l’hypothèse des coûts de transaction nuls (ne
serait-ce que pour justifier l’existence de la firme) et rejette le théorème
auquel son nom a été accolé : « Il est nécessaire
d’introduire explicitement des coûts de transaction positifs dans
l’analyse économique pour étudier le monde tel qu’il
existe ».
Finalement,
nous précise F. Lévêque, la référence à
un monde sans coût de transaction supprime l’existence des externalités
et retire du même coup la raison d’être de la recherche de
solutions d’internalisation ; En l’absence de coûts de transaction
les agents opèrent continuellement des échanges. Dès qu’il
y a un gain mutuel à se partager, ils entrent immédiatement en
contact et concluent immédiatement un accord. Les externalités
ne peuvent alors ni émerger, ni encore moins persister (l’externalité
est entendue ici au sens d’externalité Pareto-pertinente, c’est-à-dire
dont la correction améliore le bien-être collectif).
Autres
solutions privées.
-
« Les deux entreprises au fil de l’eau » (la polluante
et la polluée) peuvent fusionner. Dans ses choix techniques
de production, la nouvelle entreprise ainsi constituée va chercher à
maximiser le profit joint de ces deux unités et à concilier la
position du pollueur et du pollué réunis en une seule entité...ce
qui va conduire l’entreprise consolidée à opter pour un
niveau de rejets égal à l’optimum de pollution.
-
On peut aussi imaginer un marché de transaction de titres de propriété
sur les ressources de l’environnement qui serait organisé selon
le modèle boursier. Cette solution du marché de permis
d’émission négociables a été élaborée
par Dales (1968)
Les
solutions de réduction de la pollution que nous avons envisagées
sont les suivantes :
- la
réglementation administrative (norme ou taxe) -
la négociation bilatérale - l’entreprise
- le
marché
Le
critère de choix de la solution à retenir est celui de la minimisation
des coûts de transaction. Si le coût de la réglementation
est inférieur au coût de la négociation bilatérale,
au coût administratif de l’entreprise et au coût du marché,
le choix le plus favorable à l’intérêt de la collectivité
sera celui de la réglementation.
Ce
critère de choix est assorti d’une autre condition : les bénéfices
qui résultent de la mise en œuvre de la solution doivent être
supérieurs aux coûts de transaction. Sinon, la meilleure option
pour la collectivité est encore de ne rien faire (une issue qu’il
ne faut jamais écarter d’emblée).
Quoi qu’il en soit, le choix en faveur de l’intervention publique
ou en faveur de n’importe quelle autre solution est une question empirique.
Il est nécessaire d’étudier les solutions au cas par cas.
II)
Les politiques environnementales aujourd’hui.
Les
politiques environnementales mettent aujourd’hui davantage l’accent
sur les instruments économiques que sur les instruments
réglementaires comme les normes. Les instruments économiques regroupent
des mesures telles que les taxes sur les rejets de polluant
et l’organisation de marchés de permis d’émissions
négociables. Ces instruments laissent les agents libres de décider
des actions de dépollution, contrairement aux normes environnementales
sur les émissions, sur les techniques ou sur les caractéristiques
des produits qui prescrivent aux agents les comportements qu’ils doivent
suivre. En effet l’utilisation des normes présente, selon Boemare
et Hourcade, des effets « pervers » :
- les
normes entraînent des surcoûts dus à la difficulté
de tenir compte de la diversité des solutions pour exiger des efforts
de dépollution différenciés. -
Dans certains cas, les normes ne garantissent pas la baisse des émissions
totales. Ainsi un « moteur plus propre » est souvent plus économe,
il permet de rouler davantage pour un même budget et affecte donc la
compétitivité du rail (plus respectueux de l’environnement)
par rapport à la route ; la solution passe par une augmentation du
prix du carburant au prorata des gains d’efficacité... -
Les normes se négocient entre administrations et industries («
marchandage de la réglementation avec l’industrie »). Les
secondes faisant valoir les risques de fortes contraintes sur la compétitivité
et l’emploi. On ne sait donc jamais si la norme est trop lâche
ou si elle s’avère trop contraignante... -
Il existe un risque de manipulation stratégique des normes. Les acteurs
influents peuvent être tentés d’édicter des normes
qui correspondent à leurs intérêts au détriment
de certains concurrents (petites entreprises, firmes étrangères...)
Globalement
les instruments économiques, en donnant à chaque acteur une marge
de liberté pour choisir de s’ajuster ou de payer, permettent de
réaliser une répartition moins coûteuse des efforts de dépollution
entre pollueurs et se révèlent finalement plus efficace en matière
de lutte contre la pollution.
A)
La fiscalité écologique : les écotaxes
Il s’agit ici de faire payer les pollueurs et/ou de les amener à
internaliser les externalités négatives de leurs activités.
A cet égard il peut être intéressant de distinguer les «
taxes énergétiques », qui visent à faire payer les
pollueurs sans véritablement influencer à court terme la quantité
de pollution en raison de la faible élasticité de leurs comportements,
des « taxes environnementales », destinées dans une logique
purement pigouvienne à modifier les comportements et non à percevoir
des recettes. Quoiqu’il en soit les recettes collectées, dans le
premier cas de figure pourront aussi être mises au service de la sauvegarde
de l’environnement au travers de subventions qui aideront à la
mise en place d’une technologie plus « propre » ou qui iront
directement en direction des entreprises qui décideront de diminuer leur
activité polluante (Comme c’est le cas pour les centrales électriques
suédoises qui sont taxées proportionnellement à leurs émissions
de dioxyde d’azote, mais qui reçoivent un transfert proportionnel
à leur production d’électricité. Cette ponction suivie
d’une redistribution permet d’orienter véritablement les
comportements)
Au
Danemark, une taxe sur l’énergie a été mise en place
après les chocs pétroliers et s’applique aujourd’hui
à toutes les formes d’énergie. En 1991 a été
instaurée, pour contribuer à la lutte contre l’effet de
serre, une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, fixée
au départ à 13 euros la tonne de CO2, mais avec des exemptions
partielles pour les entreprises intensives en énergie. En 1995, la taxe
de CO2 est passée à 80 euros la tonne, mais les entreprises ont
bénéficié en échange de réductions de charges
sociales.
Un
autre exemple cité par Bureau et Mougeot (2004) est celui de la taxe
irlandaise sur les sacs de caisses en plastique. En 2002, une taxe de 15 centimes
d’euro a été instaurée sur chaque sac distribué.
En un an, la consommation de sacs a été réduite de 90%.
On le voit, les taxes pigouviennes (si elles sont élevées) peuvent
être puissantes pour modifier les comportements.
En
Norvège, les taxes sur le CO2 entrées en vigueur en 1991 ont permis
de réduire les émissions des installations fixes de combustion
de 21 % par an.
S’agissant
du double dividende (le bien être augmente à la fois du fait de
la taxe elle-même et du fait qu’elle permet de réduire des
taxes « distorsives »), des travaux ont montré qu’une
taxe sur les émissions de CO2, assortie de réductions de cotisations
sur le travail, produirait un gain net modéré en termes d’emploi.
Un certain nombre de pays (Allemagne, Pays-Bas, Danemark) ont ainsi utilisé
les taxes environnementales pour réduire les charges sociales. Au Danemark,
les écotaxes ont rapporté 320 millions d’euros à
l’Etat en 2000, et ces recettes ont été affectées
pour 233 millions d’euros aux réductions de charges.
En
France, le projet de généralisation aux consommations intermédiaires
d’énergie de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP), avancé en 1999, visait à inciter les entreprises
à réduire leurs émissions polluantes. Il a rapidement buté
sur le fait que tout prélèvement représentait une charge
importante sur certaines industries très intensives en énergie
(sidérurgie, métallurgie non ferreuse, cimenterie...) alors
même que les possibilités de réduction des consommations
d’énergie y étaient souvent très limitées.
L’objectif de réduction des consommations d’énergie
entrait en conflit avec, d’une part, l’objectif d’allocation
(risque de délocalisation des industries concernées) et d’autre
part, avec l’objectif d’équité (certaines industries
se trouvant pénalisées par rapport à d’autres moins
consommatrices d’énergie). Ce projet s’est heurté
à l’opposition des entreprises puis à une décision
d’invalidation du Conseil constitutionnel en raison de l’inégalité
des contribuables devant l’impôt que cette loi aurait entraînée
en raison d’un mode de calcul très complexe.
L’instauration
de permis d’émissions négociables permettra de séparer
complètement l’effet incitatif du dispositif (fonction du prix
de marché de la tonne de CO2 économisée) de son effet distributif
(fonction de l’allocation initiale des permis)
B) Le marché des permis d’émissions négociables.
Les
permis d’émission négociables ont vu le jour aux Etats-Unis
à la suite de l’échec de la politique fédérale
de normes d’émissions fixées et contrôlées
par l’Agence de protection de l’environnement. Dans de nombreuses
régions les normes d’émissions prescrites n’ont pas
été atteintes ; L’installation de nouvelles usines a alors
été interdite. Une dérogation a été prévue
pour les nouveaux industriels qui disposent de licences cédées
par les pollueurs historiques, ces derniers réduisant leurs émissions
d’autant. Cette première décision de commercialiser des
permis de pollution vise à concilier protection de l’environnement
et croissance économique.
Par
la suite cet instrument a été adopté par de nombreux pays.
Le protocole de Kyoto en fait un de ses instruments privilégiés.
Nous reviendrons par la suite, plus longuement sur cet instrument.
(«
Remarquons que le marché des permis négociables évoqués
ci-dessus ne partage pas une caractéristique essentielle du modèle
théorique. Les transactions ne se réalisent qu’entre pollueurs.
Les pollués ne peuvent pas acheter de permis pour les retirer de la circulation
et diminuer ainsi le niveau de pollution en deçà des limites fixées
par les autorités publiques. L’objectif collectif de dépollution
est fixé par les autorités publiques : celles-ci distribuent ensuite
les droits d’émission aux entreprises... »).
C)
La solution « négociée ».
Les
solutions privées qui mettent en relation directement les pollueurs avec
les pollués existent mais elles ne sont pas répandues. On peut
citer l’exemple, emprunté à F. Lévêque, de
la négociation entre Volvo et British Petroleum [Henry 1994] : BP décide
d’adopter un pétrole moins léger et contenant plus de soufre
pour diminuer ses coûts d’achat de matières premières.
Mais cela entraîne des émissions plus corrosives qui endommagent
les carrosseries des véhicules du constructeur parqués à
proximité. Une négociation s’engage entre les deux parties.
Il est décidé que BP prendra à sa charge la réparation
du préjudice subi par Volvo. La solution technique retenue est la couverture
des aires de stockage des voitures. Cette solution se révèle moins
coûteuse que l’installation de filtres de désulfuration à
la sortie des cheminées de la raffinerie...
On
le voit immédiatement, cette solution satisfaisante sur le plan local
et sur le plan économique ne l’est pas du tout sur un plan écologique.
La solution adoptée est totalement incomplète : une partie seulement
des externalités a été internalisée. Les émissions
corrosives de soufre n’ont pas été interrompues et elles
continueront sans doute de générer des externalités négatives,
notamment pour les générations futures...
Pour
qu’elle soit totalement efficace, la solution négociée doit
être complète, concerner toutes les parties présentes et
futures victimes du préjudice. Elle est par conséquent très
coûteuse dès lors que le nombre de parties concernées est
élevé ; ce qui est généralement le cas pour les
problèmes de pollution. La présence de plusieurs pollués
et pollueurs renchérit : les coûts de recherche de l’information
(sur la responsabilité de chaque pollueur, la hauteur des préjudices
subis par chaque pollué...) préalable à la rédaction
du contrat ; les coûts d’organisation de la négociation ;
les coûts de contrôle des engagements contractuels...
Du
fait des coûts élevés de négociation, la solution
privée la plus fréquente ne comporte pas de négociation
avec les pollués. Elle prend la forme d’engagements de
réduction des émissions pris unilatéralement par les pollueurs.
«
Il ne faut pas écarter pour l’amélioration de l’environnement
la portée et l’importance des engagements volontaires unilatéraux
des pollueurs ». Certes la démarche est très intéressée
(saisir une opportunité pour le renouvellement des techniques de production,
engager des actions de dépollution rentables car elles permettent d’économiser
des intrants ou de mieux satisfaire la clientèle...) mais leurs effets
ne sont pas négligeables (cf. Les engagements pour l’environnement
de l’industrie chimique canadienne [F. Lévêque 2004]).
Pour
autant, il y a plusieurs conditions pour parvenir à un résultat
efficace et ambitieux et pour que ces actions annoncées ne soient pas
que de la poudre aux yeux destinée à leurrer les consommateurs
et les pouvoirs publics.
Il
est nécessaire que les tiers (pouvoirs publics, associations, ONG...)
exercent des menaces crédibles, par exemple de durcissement de la réglementation,
de boycott des produits ou de manifestations autour de sites perturbant le fonctionnement
de l’entreprise. Les actions de « naming and shaming », qui
visent à « épingler » les pollueurs qui ne respectent
pas leurs engagements sont aussi un moyen efficace pour empêcher les entreprises
de développer des comportements uniquement opportunistes.
Ainsi
l’objectif ne sera atteint que si des contrôleurs indépendants
et un mécanisme de sanctions incitent les pollueurs à ne pas manquer
à leurs engagements (Dans la pratique anglo-saxone du droit, un énoncé
de bonne conduite environnementale, sans valeur juridique formelle, peut avoir
des conséquences juridiques indirectes en cas de litige lié à
l’environnement. Le juge le prendra en compte pour l’issue du procès)
;
Toujours
est-il que la politique de l’environnement connaît aujourd’hui
dans les pays industrialisés une direction qui consiste à recourir
plus fréquemment aux instruments économiques et à favoriser
le développement des engagements volontaires des pollueurs plutôt
qu’à abuser des normes réglementaires.
III)
Le marché des permis d’émissions négociables.
La
création des marchés de permis constitue une des réponses
à l’existence d’externalités dans le domaine de l’environnement.
Utilisé initialement aux Etats-Unis, cet instrument connaît une
nouvelle impulsion avec le protocole de Kyoto. Il est prévu à
partir de 2008 la création d’un marché international de
permis négociables où les pays industrialisés pourront
vendre des droits d’émission. Pour sa part l’Europe propose
depuis 2005 l’instauration d’un système d’échange
de quotas de gaz à effet de serre pour les industries intensives en énergie
et les producteurs d’électricité dans l’espace économique
européen. Ce marché prévu initialement pour le dioxyde
de carbone (CO2) devrait être élargi aux autres GES et à
d’autres activités que celles initialement prévues.
A)
Fonctionnement des marchés de permis d’émission
Au
cours de chaque période, chaque participant se voit allouer une quantité
de quotas d’émission qu’il peut échanger, chaque quota
correspond à une unité de polluant (ex : une tonne de CO2 ou une
tonne de SO2, dioxyde de soufre). A la fin de la période, tout participant
devra détenir suffisamment de quotas pour couvrir son niveau d’émission
réel. La quantité totale de quotas allouée correspond donc
à la contrainte environnementale globale imposée par les pouvoirs
publics. Le système d’échange permet par le simple jeu du
marchandage, d’établir un prix pour le quota (ex : 25 € la
tonne de CO2). Les entreprises, compte tenu de leur technologie, dont le coût
marginal de réduction des émissions est supérieur au prix
de marché du quota chercheront à acheter la quantité de
quotas pour couvrir leurs émissions aux entreprises qui auront un coût
de réduction des émissions inférieur au prix du quota.
Ces dernières réduiront leurs émissions et bénéficieront
de la vente de leurs droits jusqu’à ce que le coût marginal
de réduction atteigne le prix du marché. Il est donc avantageux
pour tous les acteurs en présence d’échanger sur ce marché.
Ce mécanisme permet donc de réduire les surcoûts associés
à la limitation des émissions, car on permet la mise en œuvre
des réductions là où les coûts correspondants sont
les plus faibles.
En
termes environnementaux, l’autorité publique fixe à travers
la quantité de quotas alloués la quantité maximale de polluants
qu’elle désire que les participants au marché émettent.
L’instauration de permis négociables permet, contrairement aux
écotaxes, de maîtriser directement la quantité d’émission
des activités concernées par le marché.
L’allocation
initiale des droits accordés peut se faire gratuitement ou aux enchères.
Une allocation aux enchères présente l’avantage de révéler
une information sur le niveau des coûts de réduction, alors que
l’allocation gratuite prend en compte les caractéristiques de la
situation initiale, héritée d’une histoire dans laquelle
le souci environnemental était partiellement ou totalement absent.
Mais comme toute institution qui se respecte, le marché de permis négociable
suppose la mise en place d’un certain nombre de règles bien précises
[Daniel Delalande 2003].
- Il
convient, tout d’abord, de définir la nature juridique des quotas
d’émission. Est-ce que ce sont des titres financiers à
part entière ou relèvent-ils de la catégorie des autorisations
administratives (susceptibles de circuler) délivrées par l’Etat
dans le cadre de sa mission de service public (préservation de la qualité
de l’air et de la santé publique) ?
Le
quota peut également être de nature administrative (« permis
d’émission » au sens d’autorisation) ou de nature
civile (« droit d’émission »). Le gouvernement français
a tranché en faveur d’une qualification de droit civil. Le quota
est assimilé à un droit meuble, auquel est associé un
droit de propriété. Ce qui peut être critiquable sur le
plan juridique et politique par certains, l’Etat pouvant se trouver
débiteur de cette créance. En effet, l’Etat, pour quelle
que raison que ce soit, voulant récupérer ces droits devra les
racheter alors qu’il les a alloués gratuitement. - Un
système de surveillance et de contrôle d’émissions
constitue également une condition du bon fonctionnement du marché.
La mise en place du marché suppose donc un renforcement du contrôle
des émissions, voire un contrôle continu au lieu de contrôles
ponctuels. Aux Etats-Unis, en ce qui concerne le marché du SO2, l’Agence
pour la protection de l’environnement (EPA) comptabilise les émissions
réelles et les échanges de quotas en volume. Elle vérifie
que chaque centrale détient au moins autant de quotas que d’émissions
réelles. La gestion des échanges financiers de quotas n’est
pas de sa responsabilité, elle est laissée aux opérateurs
boursiers. - Un
autre élément, et non des moindres, est l’instauration
d’un système de sanctions. Celui-ci a pour objet de dissuader
les entreprises de dépasser les émissions autorisées.
Aux Etats-Unis, dans le cadre du marché du SO2, la pénalité
est non libératoire. Autrement dit, pour tout excès d’émission,
l’entreprise perd à la période suivante l’équivalent
de quotas. Mais surtout le montant de la pénalité est dix fois
le haut de la fourchette du prix constaté sur le marché. - Enfin,
l’Etat doit veiller à assurer la liquidité du marché.
Aux Etats-Unis, sur le marché du SO2, une part des allocations des
participants est retenue (2,8%) puis proposée aux enchères.
Cette mise aux enchères garantit aux nouveaux entrants la possibilité
d’acheter des quantités importantes de quotas.
B) Le marché des permis d’émissions : le cas du protocole
de Kyoto.
C’est
avec le Protocole de Kyoto que les marchés de permis d’émission
(maladroitement appelés « marché des droits à polluer
») vont être concrètement envisagés en Europe et en
France dans le cadre des politiques environnementales. La création d’un
marché international de CO2 , qui devrait être opérationnel
en 2008, constitue une des dispositions les plus spectaculaires du texte finalement
adopté. Depuis, l’Union européenne a mis en chantier une
directive organisant un marché de quotas d’émission de CO2
s’appliquant à plusieurs secteurs industriels et concernant plusieurs
milliers d’installations industrielles sans toute l’Europe, directive
qui est entrée en vigueur en 2005.
1)
Le protocole de Kyoto.
En
1992, une convention-cadre sur les changements climatiques était adoptée
par 166 pays, dans le cadre du sommet mondial de Rio. En 1997, ce texte était
complété par le protocole de Kyoto. Celui-ci quantifiait l’engagement
de principe pris en 1992 par les pays développés de réduire
leurs émissions. Au stade actuel du processus, les pays du Sud ne sont
soumis à aucune contrainte du fait de la responsabilité historique
des pays développés dans l’augmentation de la teneur en
carbone de l’atmosphère...
Dans
le cadre du protocole de Kyoto, principalement les pays développés
et les pays en transition s’engageaient à réduire, sur la
période 2008-2012, leurs émissions annuelles de gaz à effet
de serre (GES, Six gaz sont concernés et les objectifs sont spécifiés
en équivalents d’émission de CO2) de 5,2 % en moyenne par
rapport au niveau atteint en 1990. Mais pour stabiliser la température
de l’atmosphère, les scientifiques considèrent qu’il
faudrait réduire les émissions de GES d’au moins 50 %.
Ce
protocole n’est entré en vigueur qu’en février 2005.
La France, du fait du poids du nucléaire dans la production d’électricité
qui émet moins de GES, a obtenu un traitement de faveur. Elle doit seulement
stabiliser ses émissions au niveau de 1990, alors que l’Europe
dans son ensemble doit les diminuer de 8 %. Par ailleurs le Protocole autorise
le recours aux « puits de carbone » (éléments naturels,
comme les mers ou les forêts qui absorbent le CO2 contenu dans l’air
et le stock) pour remplir une partie des obligations de réduction d’émissions.
Cependant la portée de ce protocole restera limitée tant que les
Etats-Unis refuseront de s’y associer (un vote négatif unanime
du Sénat américain a empêché la ratification du protocole
par les Etats-Unis censés réduire leurs émissions de 7
%). Les Etats-Unis ont été suivis dans leur refus par l’Australie.
Le Canada envisage même d’abandonner le protocole de Kyoto (-6%
d’émissions de GES d’ici à 2012 par rapport au niveau
de 1990) en ménageant ses plus gros pollueurs, pour ne pas freiner la
croissance économique. Au final, seuls 25 pays se sont effectivement
engagés à réduire leurs émissions d’ici à
2012, tandis que 11 autres, dont la France, acceptaient de stabiliser ou de
ne pas trop augmenter les leurs. Il est donc illusoire de penser que le protocole
de Kyoto puisse à lui seul sauver la planète. Mais cet accord
marque cependant la prise de conscience par la communauté internationale
de l’urgence d’une action de grande ampleur...
A
la conférence de Rio (juin 1992), en l’absence d’un accord
sur l’usage de l’instrument fiscal, la négociation s’est
concentrée sur les émissions quantitatives de chaque pays. Elle
a donc remis en cause le régime antérieur où le droit à
rejeter des GES, et donc à modifier le climat, était gratuit et
illimité.
«
Le protocole de Kyoto prévoit donc le recours à un marché
de droits d’émission de GES, où l’on déconnecte
les allocations initiales (censées être équitables) et finales
(modifiées par les échanges économiques) ». Cet accord
organise donc en quelque sorte une distribution gratuite aux gouvernements de
permis d’émissions qui seront négociables sur un marché
de permis. Les articles du protocole évoquant les échanges de
droit sont les suivants :
- Articles
3.1 et 4. Les Pays peuvent définir une bulle, au sens où
un groupe de pays s’engagent solidairement à respecter l’engagement
quantitatif global, et se réservent donc le droit de répartir
leurs engagements nationaux de façon différente. L’Union
européenne a ainsi adopté une répartition intracommunautaire
de l’effort... -
Article 3.13. Possibilité de mise en réserve
des quotas d’émission non utilisés sur la période
2008-2012. -
Article 6. Des crédits d’émission peuvent
être attachés à des projets de réduction d’émission
de GES (ex, centrales solaires...) ou de plantations végétales
contribuant à absorber le CO2 (« puits de carbone »), sous
certaines conditions. Les pays de l’Annexe B (il s’agit des pays
industrialisés et en transition) peuvent échanger ces crédits,
mais peuvent aussi, sous leur responsabilité, autoriser des personnes
morales à participer aux actions relatives à l’obtention
et au transfert des réductions d’émission obtenues par
ces projets. Ce mécanisme est baptisé mise en œuvre conjointe. -
Article 12. Le mécanisme de développement propre
autorise, sous certaines conditions, les parties de l’Annexe B à
réaliser des réductions « additionnelles » d’émissions
dans les pays hors Annexe B (en gros, les pays en développement), plutôt
que sur leur territoire national. Ces crédits pourront être acquis
sur la période 2000-2007 et utilisés sur la période 2008-2012. - Article
17. Le commerce des quotas d’émission entre parties
de l’Annexe B est autorisé.
Les
trois dernières dispositions sont souvent regroupées sous le label
mécanisme de flexibilité.
L’originalité
du protocole de Kyoto réside bien sûr dans la mise en place d’un
système de permis d’émission de gaz à effet de serre
négociables entre pays industrialisés et en transition mais aussi
dans le « mécanisme de développement propre ». Ce
dernier permettra aux pays riches, en finançant des projets de réduction
d’émission dans les pays en développement, de réaliser
une partie de leurs obligations de réduction d’émission.
(La « mise en œuvre conjointe » repose sur le même principe
mais entre pays développés). Il s’agit pour les entreprises
industrielles d’obtenir ainsi des quotas additionnels. Le chimiste français
Rhodia a ainsi fait valider, par l’agence des Nations unies chargée
de superviser ce type de projet, des projets dans son usine d’Onsan en
Corée du sud et au Brésil qui lui permettent de disposer de plus
de 80 millions de tonnes de crédit carbone qu’il pourra valoriser à
partir de 2007. Sans ce système, le respect des obligations de Kyoto
coûterait à un pays comme la France 1% de son PIB chaque année,
estime l’économiste Olivier Godard.
L’entrée
en vigueur du protocole de Kyoto est une étape importante, mais elle
ne permettra pas à elle seule d’empêcher l’augmentation
des émissions de gaz à effet de serre. Les rejets de CO2 dans
l’atmosphère devraient augmenter de 39% en 2010 par rapport à
1990 en raison de la croissance des pays émergents (notamment la Chine),
estime l’Agence Internationale de l’Energie dans son rapport 2004.
Les rejets des pays en voie de développement dépasseront ceux
des pays industrialisés vers 2020, selon l’AIE. Or les pays en
développement ne sont pas liés par des objectifs de réduction
d’émissions. Ainsi, la Chine et l’Inde refusent de limiter
leur consommation de charbon, dont ils disposent en abondance, bien qu’il s’agisse
d’une énergie fortement émettrice de CO2. Autre limite du
protocole, rappelons-le : les Etats-Unis, premier émetteur mondial de
gaz à effet de serre, refusent de le ratifier, de même que l’Australie.
Les Etats-Unis représentent plus d’un tiers des émissions
du monde industrialisé.
2) Le marché européen des droits d’émission
de CO2.
Dans
le cadre du protocole de Kyoto, l’Union européenne s’est
en effet engagée à diminuer pour 2012 ses émissions de
gaz à effet de serre de 8 % par rapport au niveau atteint en 1990. Une
directive européenne adoptée en 2003 confie à chaque Etat
la tâche de fixer la quantité de CO2 que les principaux sites industriels
étaient en droit d’émettre compte tenu de leur activité.
Un premier plan national d’allocation de quotas de CO2, pour 2005-2007,
dit PANAQ I est déjà mis en place. Cette phase est considérée
comme un test et concerne environ 12 000 sites en Europe, dont près de
1 100 sites en France. Une proposition de PNAQ II, pour la période 2008-2012,
vient d’être présentée à la Commission européenne
(28-29 novembre 2006). Le plan du Royaume-Uni (qui fixe à 246,2 millions
de tonnes ses émissions de CO2 par an) est le seul que Bruxelles a accepté
quasiment en l’état. La France, elle, a dû revoir sa copie.
Le plan initial prévoyait de distribuer à l’industrie des
droits d’émission à hauteur de 150 millions de tonnes de
C02 par an entre 2008-2012, alors qu’en 2005 ses émissions réelles
n’atteignaient que 132 millions de tonnes ( La France arguant du fait
qu’elle respecte déjà les engagements de Kyoto et que ses
industries sont déjà peu émettrices de CO2) ...En 2005,
les gouvernements européens avaient accordé plus de permis que
nécessaire, entraînant un krach du marché de CO2. Mais l’annonce,
par la Commission, du rejet de la proposition française a eu un effet
positif sur le marché européen des droits d’émission
de CO2, les cours étant en hausse de 45 centimes à 18,30 euros
la tonne...Les producteurs d’électricité étant
tenu de détenir les quotas correspondants à leurs émissions,
le prix de la tonne de CO2 est devenu une des données fondamentales du
marché de l’électricité quasiment de même importance
que les prix des combustibles.
L’Union
européenne compte donc fortement sur les Bourses d’échange
de CO2 pour respecter ses objectifs de réduction des émissions
de GES sans trop pénaliser les entreprises.
Tous
les ans en avril, chaque site concerné doit démontrer aux autorités
publiques de son pays que ses émissions de l’année passée
n’excèdent pas le nombre de permis d’émission de GES
qu’il détient, sous peine de devoir payer des amendes (40 euros
par quota non restitué, équivalent une tonne de CO2 pour la période
2005-2007, 100 euros pour les périodes suivantes). Les industriels sont
autorisés à acheter et à vendre les quotas qui leur sont
attribués. Concrètement, les quotas peuvent se négocier
de trois façons : en direct (d’entreprise à entreprise),
par l’intermédiaire d’un courtier spécialisé,
ou sur un marché organisé.
L’essentiel
des échanges de quotas est donc réalisé de gré à
gré, c’est-à-dire directement entre deux opérateurs industriels
ou financiers, souvent d’ailleurs entre unités d’un même groupe.
Mais on a assisté aussi à la mise en place de plusieurs marchés
spécialisés. En un an, pas moins de six Bourses du carbone
ont été créées en France, aux Pays-Bas, en Autriche,
en Suède, en Allemagne et au Royaume-Uni.
A
Paris, Powernext Carbon est un marché au comptant de tonnes d’équivalent
dioxyde de carbone (quotas) qui a vu le jour fin juin 2005 au sein de Powernext,
filiale d’Euronext. Il compte aujourd’hui près de 60 membres
répartis dans plusieurs pays européens et détient plus
de 60 % des marchés au comptant en Europe. C’est le marché
le plus liquide du monde avec un pic de à 2,7 millions de tonnes échangés
en mai 2006. Les droits d’émission sont des contrats soumis au
droit commercial français relatif au négoce de marchandises («
biens meubles ») et ne relèvent pas du statut des marchés
financiers. Sur ce marché, Powernext intervient comme opérateur
du marché et met à disposition une plateforme de négociation
continue...La Caisse des Dépôts, détenant les registres,
intervient comme gestionnaire du mécanisme de livraison contre paiement
et assume le rôle d’intermédiaire sécurisant les engagements
financiers et les engagements de livraison pris par les membres lors des transactions.
Comme tous les mouvements de quotas au sein du système européen
de registres, les transferts de quotas issus des transactions réaliseés
sur Powernext Carbon sont validés par le CITL (Community Independent
Transaction Log).
Les
industriels directement concernés ne sont pas les seuls à échanger
des quotas. Les gouvernements qui redoutent de devoir couvrir des émissions
supérieures aux engagements pris dans le cadre de Kyoto en acquièrent
également. Ils le font généralement par l’intermédiaire
de fonds d’investissement à capitaux publics ou mixtes. C’est le cas
notamment de l’Etat néerlandais, très mal parti pour tenir ses
engagements. Enfin, banques et autres entreprises d’investissement
interviennent aussi sur ces marchés (la finance carbone),
soit en tant qu’intermédiaire pour des tiers, soit pour acheter des quotas
pour leur propre compte. N’étant pas eux-mêmes soumis aux contraintes
du système de quotas, ils procèdent à de tels achats dans
un but purement spéculatif, en pensant gagner de l’argent demain si les
prix augmentent. Ce faisant, ces acteurs financiers contribuent à donner
ce qu’on appelle de la liquidité au marché, c’est-à-dire
à faire en sorte qu’il y ait toujours suffisamment de vendeurs et d’acheteurs
pour qu’une entreprise qui chercherait à acheter (ou à vendre)
des quotas trouve facilement un vendeur (ou un acheteur) en face d’elle. De
plus, le fait que les financiers s’intéressent au carbone est un atout
politique non négligeable dans la lutte contre le changement climatique,
compte tenu de leur pouvoir de lobbying : contrairement aux industriels, ils
ont intérêt en effet à ce que les quotas soient rares pour
qu’ils deviennent cher.
L’allocation
des quotas pour la période 2008-2012 constituera donc un test de la détermination
européenne dans la lutte contre le changement climatique.
Ainsi
Stavros Dimas, le commissaire européen chargé de l’environnement,
a présenté un « projet de législation » visant
à inclure le transport aérien dans le système européen
d’échange de permis d’émissions de CO2. Cela signifie
que chaque compagnie aérienne pourrait se voir fixer des quotas d’émission,
ce qui n’était le cas que d’activités industrielles
telles que l’énergie (56 %), la sidérurgie, le ciment ou
le papier. Mais « Contrairement aux industriels, explique Pierre Caussade,
directeur du développement durable d’Air France, nous ne disposons pas
de source d’énergie alternative au kérosène. Nous ne pouvons
compter que sur la mise en service d’avions moins gourmands en carburant, et
sur une amélioration du contrôle du trafic, afin d’optimiser les
routes aériennes et de réduire les encombrements aux aéroports.
». On devine que le lobbying des transporteurs aériens a déjà
commencé en évoquant le risque des distorsions de concurrence
en faveur des compagnies non-européennes, essentiellement américaines.
Toutefois, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a déjà
fait savoir qu’elle ne s’opposerait pas à un marché d’échanges
de quotas.
Couplée
avec l’exigence d’une révision à la baisse des quotas attribués
aux industriels par les plans nationaux d’allocations allemands et français,
cette annonce indique que Bruxelles entend bien étendre le champ de la
« contrainte carbone », en particulier au secteur des transports
jusqu’ici épargné et dont les émissions devraient augmenter
de 150 % d’ici à 2012, au rythme de la progression du trafic. Ce
qui ôtera du même coup aux industriels l’un de leurs arguments préférés
pour minimiser leurs propres obligations : les transports sont en effet responsables
de 21 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne
(UE), contre 20 % pour l’industrie, 28 % pour la production d’énergie,
17 % pour l’habitat et 10 % pour l’agriculture.
Une
critique importante est adressée au système d’échange
de quotas, elle concerne leurs effets sur les prix de l’électricité.
Le prix du kWh sur le marché est largement déterminé par
le coût de la dernière unité produite, les spécialistes
parlent de tarification au coût marginal. Or, les unités qui permettent
l’ajustement au jour le jour entre l’offre et la demande d’électricité
sont généralement des centrales thermiques au fioul ou au gaz
(voire au charbon), qui émettent du CO2 contrairement aux centrales nucléaires
ou hydrauliques qui, un peu partout, fournissent le courant de base, celui qui
est délivré en permanence. Les prix risquent donc de s’envoler
car les électriciens vont être tentés de facturer l’électricité
au prix fort sur toute la production, alors même qu’ils ne doivent se
procurer des quotas de CO2 que pour la production marginale. On comprend mieux
alors la position de la Commission européenne lorsqu’elle cherche
à mettre en place « un plan pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 60 % à 80% d’ici 2050, diminuer
la dépendance énergétique et stimuler la concurrence ».
Le
marché des permis d’émission établi dans le cadre
du Protocole de Kyoto n’est pas exempt de critiques mais le succès
des expériences passés, dans des contextes certes plus limités,
est, comme le suggère R. Guesnerie, de bon augure même si le fonctionnement
efficace du marché à l’échelle de la planète
demandera beaucoup plus de temps.
Quoi
qu’il en soit, discuter des mérites ou des insuffisances du marché
de permis, c’est certes l’évaluer par rapport aux objectifs
de lutte contre le réchauffement climatique par exemple, mais c’est
aussi le comparer par rapport aux autres instruments : « un instrument
n’est ni médiocre ni idéal dans l’absolu, il est plus
ou moins adapté à telle ou telle circonstance » (R. Guesnerie).
L’objectif
de réductions d’émissions doit être obtenu au moindre
coût : il faut mettre en œuvre les investissements de réduction
dont l’efficacité économique est la plus grande, c’est-à-dire
ceux dont le coût économique par tonne de carbone évitée
est le plus faible (dont le coût marginal est le plus faible) et ce jusqu’au
moment où l’objectif de réduction est atteint.
Dans
le cas d’une économie concrète, caractérisée
par une asymétrie d’information entre le réglementeur et
les agents économiques, et où le nombre d’agents économiques,
de technologies et de biens est considérable, personne n’est capable
de classer les mesures de « décarbonisation » par ordre de
coût croissant, et moins d’en imposer le mise en œuvre. Par
conséquent la politique environnementale reposant sur des instruments
réglementaires (« absolument nécessaires dans le cas de
pollutions localisées et/ou la dangerosité est liée à
des effets de seuil ») mis en place par un planificateur (Etat, Commission
européenne, « instance onusienne...) dont on peut légitimement
penser qu’il n’est pas nécessairement omniscient et omnipotent
peut se révéler erronée et donc très coûteuse
et inefficace. La politique qui doit être mise en place est celle qui
transfère l’effort là où il est le moins coûteux.
Ainsi l’analyse économique démontre l’efficacité
supérieure des instruments économiques sur les instruments réglementaires
(Boemere et Hourcade) :
-
ils minimisent les coûts pour un objectif donné à une
date donné. En effet les entreprises disposant d’une technologie
de production plus moderne et donc moins coûteuse, dépollue plus
et à moindre coût que les autres entreprises...Elles seront
d’autant plus incitée à la faire lorsque les efforts seront
rémunérés par le vente des permis excédentaire. -
Ils ne préjugent pas de l’option technique -
Ils révèlent l’information des entreprises (notamment lors de la mise aux enchères des droits) -
Ils permettent l’adaptation aux contextes locaux. -
Ils permettent des ajustements progressifs.
Pour
lever les réticences des industriels soucieux de préserver leur
compétitivité, de certains agriculteurs accrochés à
la défense de leur niveau de vie ou encore des périurbains en
recherche d’emploi, particulièrement sensibles aux prix élevés
des carburants, il suffit de mettre en place des systèmes de compensations,
d’autant plus que les bas revenus sont proportionnellement plus touchés
que les haut revenus. Ainsi, dans le cas de l’industrie, comme nous l’avons
vu, une partie du coût de l’écotaxe peut être récupérée
sous la forme d’une baisse des cotisations sociales. Pour les catégories
les plus pauvres, on peut imaginer, par exemple, un système d’impôts
négatifs...
Enfin,
un des avantages des instruments économiques est de proposer des outils
de coordination internationale opérationnels. Les normes réglementaires
n’ont pas de raisons d’être plus efficaces au plan mondial
qu’au plan national, « sauf dans certaines certains cas très
spécifiques comme celui de l’ozone où une technologie de
remplacement existe et où les industriels concernés sont en petit
nombre. On ne peut espérer harmoniser des milliers de normes suffisamment
différenciées selon le climat ou la géographie sans prendre
le risque de manipulations répétées ».Aussile choix
de mettreenplace des quotas de CO2 et des permis d’émission négociables
dans le cadre du protocole de Kyoto est totalement justifié. D’autant
plus que décider d’un niveau de taxe écologique (cela fusse-t-il
encore possible à l’échelle de la planète) «
interdit une prévision précise des réductions qui seront
effectivement obtenues, et donc compromet la maîtrise de l’objectif
quantitatif visé ».
Le temps presse. La Terre se réchauffe. La température moyenne
à la surface de la planète a augmenté d’environ 0,6°C
pendant les 100 dernières années, selon le Groupement intergouvernemental
pour l’évolution du climat (GIEC), un organisme qui réunit
près de 4 000 chercheurs dans le monde. Une étude sur le climat
en Arctique, publiée en novembre 2004, prédit un avenir plus sombre
encore, avec un réchauffement compris entre 4 et 7 degrés d’ici
2100. Les travaux menés pendant quatre ans par près de 300 chercheurs
membres de l’ACIA (organisme d’évaluation du changement climatique
en Arctique) montrent que la région située autour du Pôle
Nord se réchauffe à grande vitesse, entraînant une fonte
des glaces éternelles et une élévation mondiale du niveau
de l’eau. « A long terme, le Groenland contient assez d’eau
pour élever le niveau de la mer de 7 mètres », prévient
l’ACIA.
Finalement face aux risques et à l’urgence, sans doute ne faudra-t-il
négliger aucun instrument, pas plus les instruments réglementaires
que les instruments économiques.
Bibliographie
indicative :
- «
La finance carbone » Revue d’économie financière
mars 2006 - «
Fiscalité de l’environnement » rapport du CAE 1998 - «
Kyoto et l’économie de l’effet de serre » rapport
du CAE 2003 - «
Les instruments économiques au service de l’environnement, une
efficacité mal comprise ». C. Boemere et J-C Hourcade. Cahiers
français n° 327. 2005 - «
Pourquoi un marché de permis d’émissions ? Le cas du protocole
de Kyoto » R Guesnerie Cahiers français 2005 - «
Economie de la réglementation » F . Lévêque La découverte. - «
Où en est le marché du CO2 ? » F. Autret et G. Duval.
Alternatives économiques mai 2006 - «
Climat : on en parle mais on ne fait rien » Alternatives économiques
décembre 2006 - «
Emissions de CO2 : les quotas français ne convainquent pas Bruxelles
» Le Monde 28 novembre 2006. - «
La mesure des liens entre environnement et croissance » G. Gaulier,
N. Kousnetzoff L’économie mondiale 2007 Repères La découverte.
Pour télécharger cet article au format pdf, cliquez sur le lien ci-dessous :